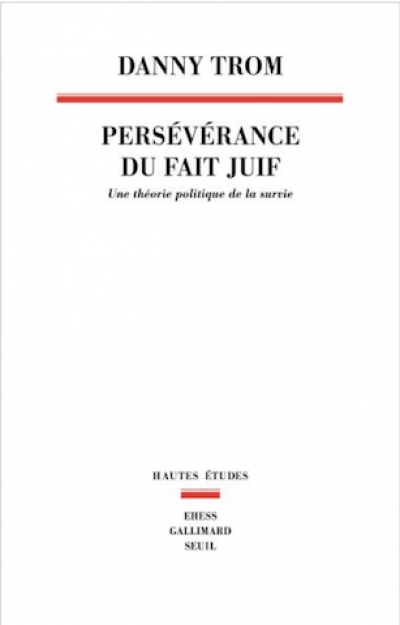Pourquoi et comment, alors que les Empires se sont effondrés, le peuple juif a-t-il survécu ? Danny Trom renouvelle cette question rabâchée et ardue en s’attelant à un entreprise originale, dans un livre dense et exigeant : démontrer comment, en s’appuyant sur la lecture du Livre d’Esther, les juifs ont pensé et mis en acte les outils qu’offre le texte biblique pour assurer leur survie, traverser les siècles sans avoir d’Etat propre, et trouver en exil un équilibre dans leur double allégeance, entre celle due au Prince régnant et celle due à Dieu. Posé autrement : et si la survie du peuple juif, exilé parmi les Nations, trouvait des raisons politiques — théoriques et pratiques — dans le rouleau d'Esther ?
Pourquoi explorer ce thème par le truchement du Livre d’Esther ? Parce que l’interrogation sur la perpétuation de l’existence de ce peuple exilé, impuissant et fragile est portée « à son point d’incandescence » (p. 26) dans le commentaire rabbinique de ce texte, par sa réactualisation permanente du Livre d’Esther. Il s’agit ici de penser une politique de la survie, une pratique de la sauvegarde — savoir politique, savoir pratique —, qui s’appuie sur un bagage élaboré et d’une densité exemplaire, à savoir le corpus rabbinique, dans sa vaste sédimentation. De ce point de vue, le récit post-prophétique que propose le Livre d’Esther puis son exégèse rabbinique est compris comme l’exploration des moyens de parvenir à survivre en exil, malgré la vulnérabilité juive (p. 22).
Le commentaire rabbinique du Livre d’Esther — un texte qui offre aux juifs des outils pour négocier leur survie en revivant en permanence le récit du projet d’extermination, qui finalement a échoué — constitue une glose sur les moyens de déjouer le plan d’anéantissement de Haman et de ses successeurs, sur fond d’expérience de la persécution. Cette expérience est profonde, fondamentale : la conception linéaire de l’histoire qu’a cultivé la tradition juive, comme sa propension à la répétition, soude le présent au passé, et associe en permanence les générations juives aux épreuves de leurs prédécesseurs.
Comme l’énonçait Hannah Arendt (citée par Danny Trom p. 38) : « Nous autres juifs avons tendance à avoir une perspective historique inversée ; plus les événements sont éloignés du présent, plus ils nous apparaissent avec acuité, clarté, netteté ». Le passé se révèle ainsi, selon le mot de Yosef Haïm Yerushalmi dans Zakhor, d’une éternelle contemporanéité, ou une manifestation toujours actualisée d’un passé immémorial. Récit inaugural, le Livre d’Esther « fonctionna comme une matrice à partir de laquelle les événements ultérieurs, manifestant des traits semblables, furent compris » par la tradition juive (p. 43). Ignorant l’histoire jusqu’à l’avènement de l’ère moderne, et même le XIXe siècle, les juifs s’en sont en quelque sorte protégés.
Ce peuple quelquefois infidèle à son Créateur dialogue, parfois en l’invectivant, avec un Dieu exigeant, souvent menaçant, ombrageux et jaloux — il exige de son peuple une alliance exclusive, s’irritant de toute infidélité (avoda zara). Ce Dieu l’accompagne néanmoins en exil ; c’est avec la défaite et l’exil que l’hénothéisme de l’ancien Israël se muera en monothéisme. Babylone, auquel succèdera le royaume de Perse — où se déroule l’intrigue du Livre d’Esther —, est à la fois l'organe de la destruction du Premier Temple et le lieu de l’exil voulu par Dieu, où Israël se réinvente.
Dans le Livre d’Esther, le regard n’est pas porté vers la terre d’Israël ni ne se relie aux dynasties des royaumes d’Israël et de Juda, et le nom de Dieu n’y apparaît même pas, figurant l’exil et l’absence qu’il signifie ; il préfigure une période où le rapport à la terre ancestrale sera rompu, l’essentiel de la vie du peuple d’Israël se jouant par la suite en dehors de la terre d’Israël. « Israël invente un dieu universel mais se l’approprie immédiatement ; il jette son exclusive sur un dieu qui pourtant était universel, donc inappropriable » (p. 51) et il pérennisera dès lors cette tension entre un Dieu universel et un dieu national.
La figure d’Esther est ici centrale, et même transgressive : Esther rompt avec l’observance de la Loi, et ce pour assurer la sauvegarde future de son peuple, diront les commentateurs. C’est une femme qui, outre qu’elle oppose au pouvoir viril une manière féminine de refus de la domination, par un passage en force suspend l’autorité de la Torah… Elle va en outre, pour garantir l’efficacité de son intervention auprès du roi Assuérus et assurer la survie de son peuple, malgré ce que la Loi prescrit, à l’instar de Moïse instituer un jeûne collectif — alors qu’auparavant aucun des Prophètes n’avait osé ajouter ou retrancher quelque chose à la Torah. La capacité d’aménagement de la Loi par le peuple d’Israël est donc établie dans le Livre d’Esther, ce qui sera essentiel, par la suite, pour la halakhah, la Loi juive.
La grandeur du rôle d’Esther, nous dit Danny Trom, est toute politique : l’espoir qui se dégage du commentaire rabbinique du Livre d’Esther « n’est nullement la rédemption qui suivra la catastrophe, pas même la réitération des espérances prophétiques d’un retour des exilés sur leurs terres et de la reconstruction du temple détruit, mais le sauvetage ponctuel du peuple et l’assurance qu’Israël persévère en exil » (p. 249). Esther veut la survie de son peuple, plutôt que la moitié du royaume que le roi Assuérus veut lui accorder — une survie physique, dans le concert de l’histoire, et non une survie spirituelle, comme le suggèrera le christianisme.
Choisissant plutôt Franz Rosenzweig contre Léo Strauss, Danny Trom s’attache donc à expliquer la durabilité du fait juif davantage par l’expérience de l’exil, que le peuple juif a pleinement intériorisée, que par l’expérience de la Loi révélée : en exil, Israël expie son infidélité à son Dieu, mais dans le même temps il y glorifie sa propre existence, lui qui résiste à l’histoire alors que les Empires disparaissent, lui dont Dieu a décidé que sa bienveillance protectrice assurerait la survie, l’invincibilité éternelle de son peuple. Non pas que Danny Trom rejette en la matière le rôle de la Loi : il s’agit effectivement de souligner le rôle de celle-ci, « mais en tant qu’elle est inscrite dans la relation entre Israël et son protecteur, donc dans une construction coutumière paléo-politique » (p. 419). Tenir à la Loi, c’est ne pas reconnaître la défaite, c’est demeurer fidèle au pacte (brith, l’alliance), c’est assurer sa conservation.
L’observance de la Torah sera le salaire payé par le peuple d’Israël en échange de sa protection ; c’est en exil que le peuple choisira pleinement et volontairement la Torah, elle qui lui était imposée sur sa propre terre, disait déjà Maïmonide (p. 256). L’exil, en quelque sorte, accomplit pleinement l’alliance, qui est un pacte politique ; et Dieu continue de gouverner son peuple par le truchement de la Loi qu’il lui a donnée, tout en partageant son règne avec un Prince civil, à condition que ce dernier n’interfère pas avec la Loi divine révélée — en même temps qu’il gouverne indirectement son peuple par le truchement du Prince. En exil, l’étude de la loi sera dans le même temps une ré-interrogation permanente des motifs de la défaillance du peuple d’Israël dans sa relation avec Dieu.
« En exil, l’attachement à la Torah est un choix parce que la loi d’Israël entre dans un espace de concurrence avec la loi du pays de résidence, de la même manière qu’une politique affirmative d’allégeance hiérarchisée doit se déterminer dans le royaume étranger parce que le grand roi (le Prince) entre en concurrence avec le roi du monde (Dieu) » (p. 264) : Israël s’accomplit ainsi pleinement en exil, nous fait comprendre Danny Trom. Son existence en diaspora est toute politique, ce que Spinoza, qui le premier clarifia que le judaïsme est un fait politique et que la Loi de Moïse est la Loi politique des juifs, considèrera comme anormal (pp. 305 et 422).
Durant l’exil, la menace de destruction des juifs est permanente, mais elle est obviée par l’intercession auprès du Prince et l’alliance avec celui-ci — ainsi, Amalek sans cesse disparaît et renaît ; en annonçant « Souviens-toi d’Amalek », le Deutéronome augure la récurrence de la menace de destruction, tout au long des générations (p. 139). Et Danny Trom de développer sa démonstration sur une « axiomatique du gardien » : un Etat protecteur, un souverain « régnant par autorisation divine », chargé d’assurer la sauvegarde d’Israël. Il y a ainsi une persévération politique du fait juif, le développement d’une politique d’auto-conservation, dans une double relation vassalique qui s’institue pour le peuple d’Israël, avec le Prince et avec Dieu.
Avec la fin des Royaumes d’Israël et de Juda, c’est en effet le Prince étranger qui va assurer en la partageant la fonction de protection du peuple d’Israël, et ce avec Dieu. Israël, nous dit Danny Trom (pp. 174sq), a en somme deux Rois protecteurs, deux faces d’un même visage, le Roi étranger auquel il est soumis et son dieu (Roi des Rois) qui sous la forme de sa présence (shekhina) accompagne son peuple en exil : il en résulte une « structure de double allégeance asymétrique », le Roi étranger régnant par la grâce du Dieu protecteur d’Israël. Le corpus interprétatif rabbinique va dès lors sans cesse rechercher le point d’équilibre qu’il convient de tracer entre ces deux instances garantes de la survie : « Entre les deux pôles de l’expérience juive de la présence de Dieu dans l’histoire (…) — présence qui sauve (de l’ennemi) et présence qui prescrit (la loi) —, la tradition du gardien accentue nettement la première » (p. 429).
Ce n’est donc pas le messianisme qui assure la conservation d’Israël, contrairement à ce que conviait à penser l’historien de la mystique juive Gershom Scholem. La tradition du gardien, nous dit Danny Trom, invite à opérer une déflation de la figure du messie et apaiser la tension que suscite et même dramatise l’attente messianique — le penchant anti-messianique était déjà celui de Maïmonide (p. 270). La tradition du gardien est ainsi une « persévérance patiente ».
Historien autant que sociologue, Danny Trom insiste sur le rôle des shtadlanim (puis des schutzjuden, ou juifs de Cour), figures centrales de la politique juive en exil, ces intercesseurs qui à l’instar d’Esther et jusqu’à Herzl, le dernier d’entre eux, agirent auprès des Princes pour assurer la protection des leurs — alors que souvent l’historiographie juive moderne les a éreintés. Les juifs en exil constituent ainsi un corps politique qui par un moyen politique, à savoir la transaction, négocie sa survie — jusqu’à ce que sa confiance en ce système soit mise à mal, puis définitivement érodée avec la shoah. Le Prince en qui la confiance est placée ne pouvait être un Prince criminel, Assuérus l’avait montré, et la sidération n’en fut que plus forte avec le génocide hitlérien, les juifs n’ayant pas développé les dispositifs mentaux nécessaires pour faire face à la réalité advenue de l’anéantissement.
La politique d’auto-conservation juive va pourtant s’adapter aux formes de la modernité politique, à travers l’évolution des expressions de la souveraineté, et se confronter à ses crises majeures. La modernité, déjà, et l’émancipation, comme l’apparition de l’État-nation et donc de la souveraineté populaire, ont en effet mis à mal le système de protection que les juifs avaient auparavant perpétué dans la triangulation Roi/Roi des Rois/peuple. Elle s’est doublée de la question de savoir comment l’élément juif au sein de l’État (non juif), pense non seulement le rapport à l’Etat où s’accommode de la loi de l’État mais, plus profondément, pense son existence même, sa pérennité au regard d’une souveraineté qui agrège des entités multiples et historiquement très éclatées, dont le lien à l’État n’est pas toujours territorial…
La modernité a en effet bouleversé le schéma de l’axiomatique du gardien déployée des siècles durant. Elle a été compensée par le sionisme politique et la création de l’Etat d’Israël, dernière forme de la politique juive. L’Etat d’Israël, en effet, « Etat-abri » perpétuant l’axiomatique du gardien, « prolonge le dispositif traditionnel de survie en exil plutôt qu’il ne l’annule » (p. 31), en l’adaptant à sa forme stato-nationale et en l’ajustant à son époque. Cet Etat n’est, écrit Danny Trom, ni restauration, ni rédemption, mais l’avatar ultime du gardien, de l’espace de protection des juifs dans une ère « post-Esther » où s’est accompli ce qui paraissait impensable dans la logique du Livre d’Esther, à savoir la shoah.
En voyant l’Etat d’Israël comme une sorte de substitut au rôle de protection qu’assurait auparavant le Prince, la création de cet Etat est ainsi réintégrée dans la continuité de l’histoire du peuple juif, normalisée en quelque sorte. Le recours au passé pour en justifier l’existence ne serait au demeurant que rhétorique : l’Etat ne serait pas un Etat juif, mais un Etat pour les juifs. Le sionisme, puis l’Etat d’Israël, n’ont pas moins imaginé la nation juive que ne l’ont fait d’autres nations modernes, et il aurait plus réinventé que perpétué sa culture, nous dit Danny Trom (pp. 360-361)
La pérennité du fait juif, conçue par d’aucuns comme une anomalie de l’histoire, un phénomène rétif au sens de l’histoire, trouve ici une explication politique. Concluons : le récit du Livre d’Esther, ruminé des siècles durant par la casuistique et l’exégèse rabbinique, constitue un savoir, qui « permit aux juifs d’anticiper les périls et d’assurer leur survie. Sa constance répond à une logique fonctionnelle : si le livre d’Esther vient soudainement à l’esprit de juifs émancipés ignorant la tradition, c’est que ce récit s’est solidifié en un habitus, formé par l’accumulation répétée d’expériences » (p. 417). Les près de cinq cents pages consistantes de Danny Trom sont de ce point de vue des plus éclairantes.
Jean-Philippe Schreiber (ULB).